Le 23 juin nous avons été amenés à nous prononcer sur l’opportunité ou non de rejoindre un décret liste concernant le recul du trait de côte. Une réunion préparatoire a été demandée par la ville de Fort-Mahon, à laquelle les conseillers municipaux de notre village ont été conviés (étaient présents : M. TAECK, Mme DESMOLINS, Mme BIGET et moi-même). Cette réunion organisée par la préfecture et les services de l’État était l’occasion de poser nos questions afin de mieux comprendre les enjeux. La CCPM (Communauté de Commune du Ponthieu-Marquenterre) était également représentée.
Il est important de faire la différence entre les différents type d’inondations. Quand nous parlons de recul du trait de côte nous parlons d’érosion de la côte. En bref, la mer gagne du terrain sur la terre, petit à petit. Ce phénomène ne se produit pas partout (certaines zones s’ensablent par exemple, et donc le trait avance, au contraire). Il ne faut pas non plus le confondre avec les risques de submersion marine (tempête et vagues) ou d’inondation liées à des pluies importantes.
Le sujet est assez complexe, et tout ce que j’en sais est ce que j’ai retenu et compris des deux heures de réunion à Fort-Mahon-Plage. Ces explications ne sont donc pas exhaustives, et méritent d’être approfondies. Ce qui suit est donc à prendre avec des pincettes car je ne prétends pas connaître le sujet sur le bout des doigts, ni avoir été formé aux enjeux. L’idéal serait que la municipalité organise un réunion publique pour expliquer la situation aux habitants. Cela nécessite que les élus soient formés plus sérieusement sur la question, et il faudrait inviter les responsables au niveau de l’État, comme lors de la réunion à Fort-Mahon-Plage.
Pourquoi ce décret ?
Les dédommagements liés à l’érosion ne sont plus pris en charge par le fonds Barnier (en savoir plus ici). Ce sont les communes qui deviennent responsables de l’indemnisation de la perte de biens immobiliers liés à ce phénomène. Vous imaginez le problème : les communes n’ont pas l’argent pour rembourser les propriétaires. L’idée est donc de mettre en place des « zones de risques », à horizon 30 ans et 100 ans. Ces zones de risques veulent dire qu’on estime que la mer aura englouti ces zones là à cet horizon. Ces zones seraient définies par les communes elles-mêmes.
Par exemple, si quelqu’un décidait de faire construire dans la zone à 30 ans, il ne pourrait pas être dédommagé car il aurait construit en connaissance de cause : il savait que sa maison serait sous l’eau d’ici 30 ans. De plus il devrait payer en avance la sommes nécessaire pour la destruction de la maison avant qu’elle ne soit avalée par la mer. C’est assez logique finalement : qui ferait construire une maison dont il sait qu’elle serait condamnée au bout de 30 ans ? Et c’est normal que ce ne soit pas à la collectivité, à nos impôts, de payer pour sa destruction.
Ce décrét est donc un outil proposé par l’État aux communes pour gérer cette situation. Une étude va être demandée à un bureau d’étude pour modéliser le recul (ou l’avancée) du trait de côte sur le littoral de la CCPM. Ensuite ce sera aux communes elles-mêmes de déterminer les zones à risques de leur territoire. Favières est concernée car nous sommes une commune du littoral, mais les constructions ne sont pas implantées sur le littoral. Aussi il est difficile de dire si les habitations sont concernées par l’érosion de la côte. Je n’ai aucune idée de l’impact pour les terres agricoles qui pourraient se retrouver dans une telle zone, je n’ai pas l’impression qu’elles soient concernées par ce décret, mais c’est à vérifier.
Le nombre de communes inscrites sur le décret permet à l’État de calculer des montants de subventions pour le fonds verts. Aussi, si une commune n’est pas inscrite, elle pourrait se voir refuser des subventions si j’ai bien compris.
Comment fonctionne le décret ?
Le décret est mis à jour tous les ans si j’ai bien compris – mais les informations semblent être un peu contradictoire à ce sujet – c’est donc à confirmer. Ainsi il serait possible d’entrer et de sortir de cette liste tous les ans.
L’inscription sur la liste oblige dans la première année à commander une étude pour modéliser le recul du trait de côte. Il a été indiqué lors de la réunion à Fort-Mahon que l’État subventionnait cette étude à 80%. Les 20% restant sont à la charge de la CCPM. Favières ne paye donc pas directement cette étude.
Une fois l’étude livrée, la commune devra se décider sur les zones de risques à 30 et 100 ans.
Au final, l’idée, si j’ai bien saisi, est de supprimer le risque « érosion » du PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels), plan élaboré au niveau de l’état, pour le déplacer vers ce nouveau support, élaboré à l’échelle locale. Cela redonne donc du pouvoir à l’échelon local quant à l’aménagement du territoire, mais c’est à double tranchant : les communes deviennent responsables de ce risque, et doivent donc se garantir contre des indemnités qu’elles n’auraient pas les moyens de payer.
Quel est l’historique ? Qui en fait partie ?
La seule commune de la CCPM à y être inscrite depuis 2022 est Saint-Quentin-en-Tourmont. Mais cela sans réel effet d’après les échanges que j’ai pu avoir avec le Maire de cette commune, car ils était seuls. Voici le décret en question, pas encore mis à jour à l’heure où j’écris ces lignes.
Qu’en est-il de favières ?
Le Conseil Municipal a voté à la majorité (8 voix pour, 1 voix contre) en faveur de l’inscription de la Commune sur ce décret. Le vote a ensuite été validé au niveau de la Communauté de Communes du Ponthieu-Marquenterre (voir la délibération ici).
Il faut savoir que ce sujet avait déjà été porté au vote en 2022. À l’époque, le Conseil Municipal l’avait rejeté à l’unanimité. Les « anciens » élus du Conseil avaient donc déjà eu l’occasion de réfléchir à cette problématique, et cela aurait pu être précieux pour avoir des explications complémentaires sur le sujet. Malheureusement, lors que j’ai demandé en séance les raisons du refus en 2022, aucune explication précise de m’a été donnée. M. le Maire m’a indiqué que chacun avait voté en fonction de, je cite, ses « convictions personnelles ». Je ne sais pas ce qu’il faut en comprendre.
J’ai donc fouillé les archives lors de cette réunion, et j’ai trouvé le Compte Rendu du Conseil de Février 2022. Malheureusement, comme vous pourrez le lire vous-même, il ne comporte aucune information intéressante pour expliquer ce vote et aider dans notre décision. Voici l’extrait en question :
Délibérations du conseil:
Avis sur intégration de la commune sur la gestion du Trait de côte ( DE_2022_003)
La Loi Climat et Résilience a été adoptée en août 2021.
Elle intègre notamment, des dispositions concernant le recul du trait de côte qui introduit de nouvelles obligations et de nouveaux outils pour les communes concernées. Les communes concernées vont être définies par un décret du Gouvernement prévu pour le mois de février 2022.
Dans le cadre de l'élaboration de celui-ci, Madame la Préfète de la Somme nous consulte pour savoir si nous désirons que la commune de Favières soit intégrée à cette liste de communes. Une note d'information précisant les principaux enjeux a été transmise à l'assemblée pour prendre la décision d'intégrer ou pas cette liste de communes.
Le Conseil après en avoir délibéré, à l'unanimité décide de rejeter la proposition d’intégration de la commune au trait de côte
Votants 10 : Pour 0 Contre 10 Abstention 0
Ce n’est qu’après notre séance de Conseil Municipal du 23 juin et en rédigeant le PV de la séance que Mme SOHET, qui avait participé au 1er vote en 2022 a retrouvé dans ses mails une version secrète et non publiée de la réunion du 8 février 2022… C’est dommage, cela aurait été plus intéressant de faire cette recherche avant ! Nous donner l’information après le vote n’est pas très utile… Je crois que cela est assez caractéristique du manque de préparation des séances dont je me plains depuis des mois, et qui dans certains cas nuisent considérablement à la compréhension des sujets soumis au vote !
Conclusion
Il faut désormais attendre l’étude. Ensuite le Conseil Municipal devra ensuite décider lui-même des différentes zones de risque (à 30 et 100 ans).
Il est indispensable d’organiser une réunion publique avec un maximum d’acteurs (élus locaux, CCPM, services de l’État) pour informer les habitants plus en détail.
à bientôt,
Jean-Matthieu
Retrouvez la suite de cet article ici.
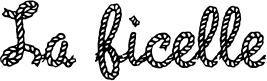
Une réponse à « Recul du trait de côte (1/2) – CM du 23 juin »